Bulletin N°46






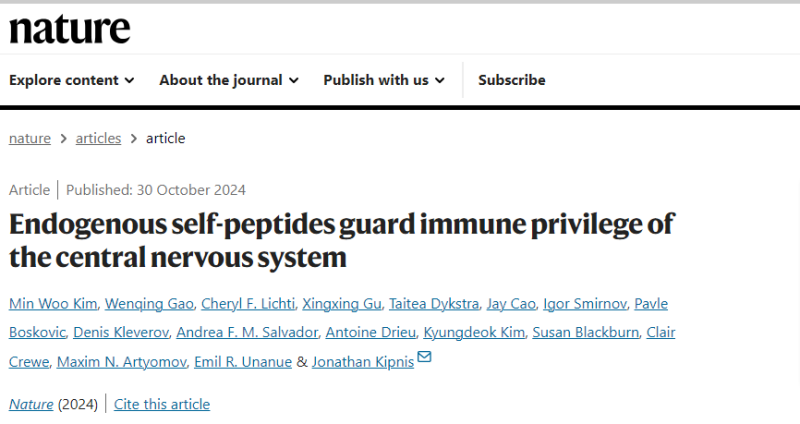
Les brèves du Bulletin N°46
Article N°1
La déplétion microgliale réduit la pathologie neuronale liée à l’APOE humaine dans un modèle chimérique de maladie d’Alzheimer.
Cell Stem Cell – Novembre 2024
Article N°2
Le blocage de CCL2 combiné à un traitement par inhibiteurs de PD-1 et de P-selectin prévient le développement de métastases cérébrales du cancer du sein.
Brain – Novembre 2024
Article N°3
Les interactions entre microglie et cellules souches neurales de la zone sous-ventriculaire impactent la réponse neurogénique dans un modèle murin d’ischémie corticale.
Nature Communications – Novembre 2024
Article N°4
Les protéines dérivant du long RNA non-codant Lnc-H19 modèlent le microenvironnement immunosuppresseur du glioblastome.
Cell Reports Medicine – Novembre 2024
Article N°5
Un nouveau modèle murin de démyélinisation cérébrale inflammatoire mimant l’adrénoleukodystrophie liée à l’X : apport physiopathologique et identification de cibles thérapeutiques potentielles.
Annals of Neurology – Novembre 2024