Bulletin N°45
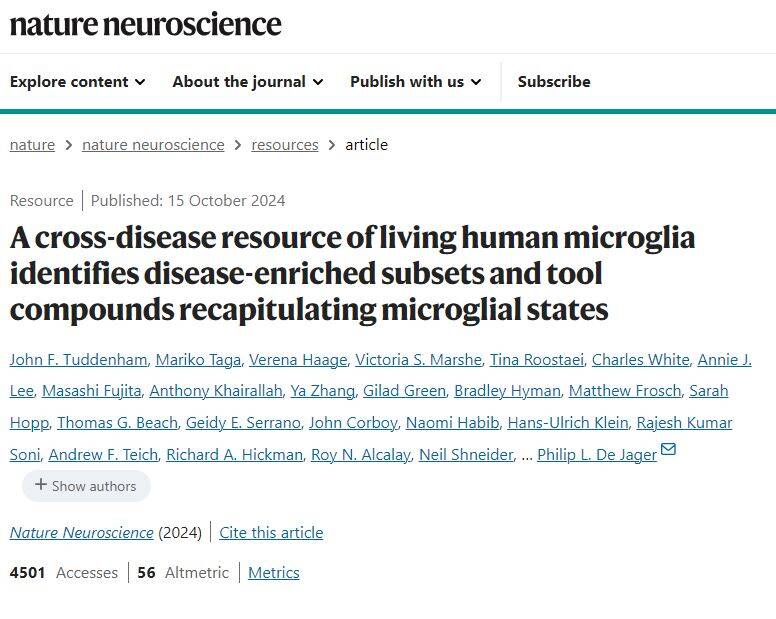




Les brèves du Bulletin N°45
Article N°1
NPC1 via le gastrosome est l’un des liens moléculaires associant le transport du cholestérol à la morphologie des cellules microglies.
Nature Communications – Octobre 2024
Article N°2
Traitement de métastases cérébrales résécables par association de la radiochirurgie stéréotaxique pré-opératoire et du traitement par dexaméthasone en péri-opératoire : une étude pilote à deux bras évaluant les résultats cliniques et les corrélats immunologiques.
Nature Communications – Octobre 2024
Article N°3
Cibler la voie de signalisation TLR3/ARN double brin exosomal atténue la tolérance à la morphine et à l'hyperalgésie.
Cell Reports Medicine – Octobre 2024
Article N°4
L'imagerie in vivo de la moelle épinière de la souris montre que la microglie exerce un effet neuroprotecteur en situation de lésion axonale.
Nature Communications – Octobre 2024